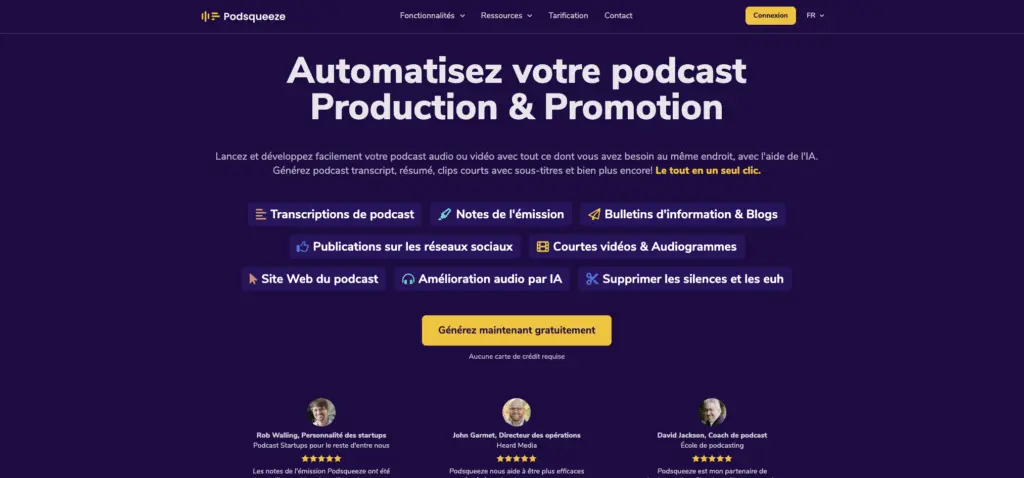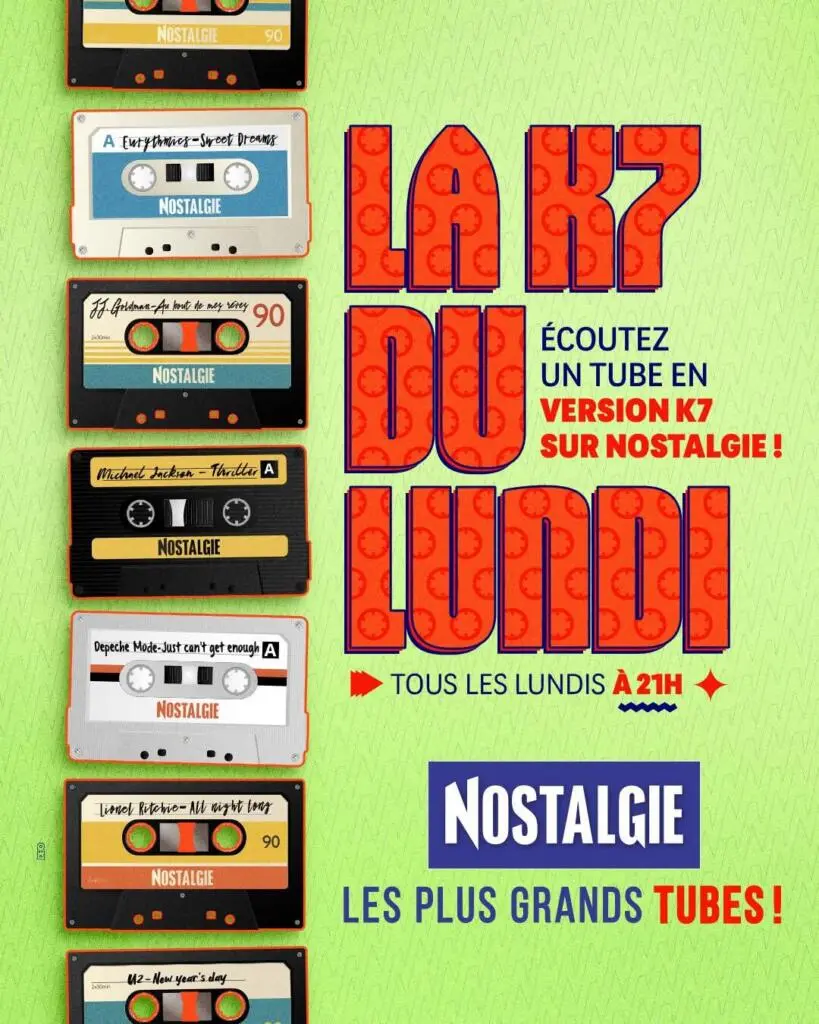Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a examiné les bilans des radios du secteur public pour l’année 1996 et procédé successivement à l’audition le 24 juillet, de M. Michel Boyon, président de Radio France, accompagné de MM. Daniel Boudet (conseiller du président), Gilbert Denoyan (directeur général délégué à la coordination des antennes et au développement), Jacques Santamaria (directeur des programmes de France Inter), Jean-Luc Hees (directeur de la rédaction de France Inter), Patrice Gélinet (directeur de France Culture), Olivier Nanteau (directeur du Mouv’) ; le 29 juillet de M. Jean-Paul Cluzel, président de Radio France internationale, accompagné de Mme Anne Toulouse (directeur de l’information), de MM. Philippe Tariel (directeur des affaires financières et de la gestion) et Franck de Nebehay (chargé de mission auprès du président).. Radio France
La situation financière de la société apparaît satisfaisante. Radio France a en effet clos l’exercice 1996 avec un résultat comptable légèrement bénéficiaire de 0,9 MF (+ 2,4 MF en 1995).
La dotation de la société en produit de la redevance s’est élevée à 2 108,7 MF, en diminution sensible par rapport à l’exercice précédent (2 335,5 MF).
Toutefois, les autres ressources publiques (subventions) sont passées de 39,1 MF à 343,4 MF.
En augmentation de 9,6 % sur l’année 1995, les recettes de publicité et de parrainage ont atteint un niveau record avec 140,7 MF.
L’audience globale des programmes du groupe Radio France a légèrement progressé (27,1 % pour 26,6 % en 1995). Cette situation résulte pour l’essentiel d’une hausse de l’écoute des radios locales considérées dans leur ensemble (6,4 % pour 5,8 % en 1995). Comme l’année précédente, l’audience de France Info s’est élevée à 10,4 %. Celle de France Inter a fléchi (11,4 % contre 11,7 % en 1995).
L’audience nationale de France Musique est restée stable. Celles de France Culture et de Radio Bleue ont enregistré une très légère hausse.
De nouvelles orientations ont été définies pour certains programmes, se traduisant en particulier par une refonte de la grille de France Inter, qui a principalement porté sur la fin de semaine, un accroissement des émissions et rubriques à caractère culturel et artistique, notamment sur France Inter et France Info, ainsi qu’une diversification plus grande des genres et styles musicaux dans la programmation musicale des antennes nationales.
Une extension a été donnée aux émissions interactives et aux programmes destinés aux jeunes. De même, ont été programmées en plus grand nombre émissions et séries centrées sur le patrimoine culturel national et régional.
L’année 1996 a été également marquée par le lancement, au mois d’avril, de la banque de programme Sophia (musique et informations) à l’intention des radios associatives et des radios commerciales indépendantes. A ce jour, plus de 70 radios sont abonnées à Sophia.
La société s’est conformée de manière satisfaisante aux obligations de programme inscrites à son cahier des missions et des charges.
Dans les programmes de variétés, la place majoritaire accordée à la chanson française a été maintenue.
S’agissant de la création musicale, les oeuvres créées à l’antenne sur France Musique et France Culture ont représenté un volume supérieur à celui de 1995.
Dans un volume financier identique à celui de 1995 (1 MF), les commandes passées par la société ont progressé en nombre, avec une part accordée aux compositeurs français en augmentation sensible.
Dans le domaine de la fiction radiophonique, les commandes, achats ou primes de textes inédits se sont élevés à 5,6 MF (5,4 MF en 1995). Les commandes d’oeuvres originales à l’intention de France Culture ont progressé.
Le volume global de diffusion est resté similaire à l’échelle nationale, avec cependant un renouvellement partiel des émissions relevant de ce genre sur France Inter. Il s’est accru sur le réseau des radios locales, mais les nouvelles productions réalisées ou mises en chantier en 1996 par les ateliers de création régionaux ont diminué, en nombre et en volume.
Enfin, Radio France a continué de s’adapter aux nouvelles technologies et à prendre une part active à leur développement : son numérique (DAB), Radio Data System (RDS), satellite numérique et réseau Internet.
Toutefois, dans un contexte général de rigueur budgétaire pour l’audiovisuel public, le Conseil s’est montré préoccupé de la situation actuelle et de l’évolution du groupe Radio France.
Il s’est en particulier interrogé sur les conséquences internes induites par la refonte, déjà opérée ou à venir, des grilles de France Inter et de France Culture, ainsi que par la diffusion, présente et future, de la nouvelle radio destinée à un public jeune (le Mouv’).. Radio France internationale
L’exercice 1996 fait apparaître un résultat comptable déficitaire de 53,8 MF (+ 0,4 MF en 1995).
Pour financer certaines de ses activités (mise en service de nouveaux émetteurs ondes courtes, rénovation des outils de production et de diffusion, lancement des nouveaux formats de programme passant par un accroissement des effectifs des structures rédactionnelles,…), la société a, en effet, dû recourir à un prélèvement de 60 MF sur son fonds de roulement. Le niveau de la trésorerie est ainsi passé de 82 MF en 1995 à 35,3 MF en 1996 (124 MF en 1994). Le Conseil s’est inquiété de cette baisse continue.
Dans le domaine de la diffusion, l’année s’est caractérisée par une consolidation de la présence de RFI sur l’ensemble des vecteurs qu’elle utilise à cet effet (OC, FM, OM, câble, satellite).
Le dispositif technique nécessaire à la diffusion ondes courtes a été renforcé, tant en termes qualitatif que quantitatif, avec la mise en service sur le sol national de nouveaux émetteurs de 500 KW et un recours élargi aux émetteurs de pays étrangers. Dans le même temps, cette diffusion OC a été géographiquement réajustée.
Pour l’acheminement et la transmission de ses programmes, la société a continué de recourir au satellite, avec un développement particulier donné à la diffusion directe et au numérique.
En ce qui concerne la diffusion en modulation de fréquence, la société a étendu ses implantations en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique, via des relais intégraux et surtout des reprises partielles de ses programmes en français et en langues étrangères.
Par ailleurs, RFI est aujourd’hui davantage présente sur les réseaux câblés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, et sur les ondes moyennes, surtout sur le continent américain.
S’agissant des langues utilisées à l’antenne en diffusion internationale, la société propose, en sus du français, des émissions en 18 langues qui ont connu à l’automne 1996 un accroissement de leur volume de diffusion. Tant pour ces émissions que pour celles en français, l’onde courte demeure le principal vecteur des programmes de la société.
En matière de programmation, l’innovation la plus marquante aura été le lancement, au mois de septembre 1996, d’une chaîne mondiale d’actualité en français et en continu (RFI 1 ou RFI Monde) avec une antenne spécifique (RFI 1 Afrique) et d’une chaîne consacrée exclusivement à la diffusion internationale des émissions en langues étrangères (RFI 2), ainsi que la création d’une chaîne entièrement dédiée à la musique (RFI 3 ou RFI Musique). Il s’agit, dans ce dernier cas, d’une banque de programme destinée à être reprise, à la demande, par des radios partenaires.
En ce qui concerne la diffusion nationale, plus d’une quarantaine de radios locales privées françaises de catégorie A ou B (dont 1/4 situées dans les DOM-TOM), reprennent, en complément de leur programme propre, le signal RFI, qui leur est fourni à titre gracieux.
Le Conseil estime souhaitable une clarification des missions de RFI dans ce domaine, dans la mesure où cette activité s’exerce sur un terrain concurrentiel, en métropole avec la banque de programme Sophia de Radio France, et dans les DOM-TOM, avec les programmes de RFO.
En 1996, Radio France internationale a convenablement rempli les obligations générales ou particulières inscrites à son cahier des charges, et notamment les missions spécifiques qui lui sont imparties.
Il en a été ainsi en particulier avec la programmation d’émissions sur la langue et la culture françaises et d’émissions d’enseignement et de perfectionnement du français. Par ailleurs et comme à l’accoutumée, la société a programmé des émissions destinées aux Français de l’étranger.
RFI a consacré à la musique française et à la chanson francophone une place majoritaire au sein de la programmation musicale (70 % de la diffusion dont 60 % pour la seule chanson d’expression française).
La société a aussi rendu compte des divers aspects de la vie et de l’actualité de la société française, notamment dans le cadre de ses journaux d’information, de chroniques, de rubriques et d’émissions spécialisées.
RFI s’est acquittée de ses obligations en matière de coopération culturelle et technique, de fourniture de programmes enregistrés et d’éléments sonores et écrits.
La société s’est également attachée à suivre les évolutions technologiques (DAB, Internet, satellite numérique).
S’agissant enfin de la restructuration du pôle audiovisuel extérieur de la France voulue par les pouvoirs publics et qui s’est déjà traduite par la cession à RFI, en 1995, de Radio Paris-Lisbonne par la SOFIRAD et un rapprochement, en novembre dernier, avec RMC Moyen Orient via le transfert des actions de la SOMERA, le Conseil note avec satisfaction le rôle central dévolu à Radio France internationale en matière radiophonique, en exprimant le souhait que soient dégagés les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de ces nouvelles missions.
31 juillet 1997Communiqué n° 349 du 31 juillet 1997